
La pratique du breton de l'Ancien Régime à nos jours
la-pratique-du-breton.org
La thèse de Fañch Broudic en accès libre

Eur Breizad oc’h adkavout Breiz.
Quand Roparz Hemon découvre la Bretagne
Les premiers textes théoriques, publiés d'abord dans Breiz Atao, puis dans la revue Gwalarn
Que l'on puisse - et doive - inverser un processus susceptible de conduire à terme à la marginalisation de la langue bretonne, c'est la conviction affichée par Roparz Hemon, alias Louis Némo [1], moins de dix ans après la controverse qui amena Emile Masson à se séparer d'Yves Le Febvre. Entre-temps, la Première Guerre mondiale avait impliqué les Bretons dans un brassage de population sans précédent. Moins d'un an après la fin du conflit, paraissait, en janvier 1919, le premier numéro d'un nouveau mensuel, Breiz Atao [La Bretagne pour toujours], marquant la naissance d'un véritable mouvement nationaliste, à la fois politique et culturel.
Le breton n'était pas la langue maternelle de Roparz Hemon. C'est à l'âge de 23 ans qu'il fournit ses premiers articles en cette langue à Breiz Atao. Deux ans plus tard, en mars 1925, il est le fondateur et le directeur d'une nouvelle revue littéraire intégralement en langue bretonne, Gwalarn [Nord-Ouest], qu'il vient de lancer et qui durera près de vingt ans, jusqu'en 1944. Dans l'un et l'autre périodiques, Roparz Hemon fait paraître des éditoriaux et articles théoriques, qu'il réunira quelque temps plus tard en volume sous le titre significatif de Eur Breizad oc'h adkavout Breiz [Un Breton redécouvre la Bretagne] [2].
Que la Bretagne ait eu, pour le néo-bretonnant qu'était Roparz Hemon, tous les attraits d'une nouvelle découverte, cela ne fait guère de doute. L'homme qui, en un demi-siècle, deviendra l'écrivain de langue bretonne le plus prolixe, se place alors au pôle extrême d'un nationalisme qui se révèle autant une répulsion viscérale à l'égard de tout ce qui peut être français en Bretagne, qu'une affirmation péremptoire de la bretonnité. Mais son horizon ne se limitait pas à son pays. Ses articles doctrinaux témoignent au contraire d'un tiers-mondisme peu courant pour l'époque, mais aussi, simultanément, de ce que nous appellerons provisoirement un conservatisme - que partageaient alors les droites et surtout les extrêmes-droites européennes.
"L’esprit sain et pur de la jeune littérature bretonne" versus "la putréfaction des grandes littératures européennes"
En effet, au moment où Gandhi lance, en Inde, son programme de boycott des institutions coloniales et des produits européens, Roparz Hemon le propose en exemple au mouvement de renaissance des pays celtiques, ainsi que le poète Rabindranath Tagore, d'ailleurs placé en exergue de Eur Breizad oc'h adkavout Breiz. Mais au moment où le surréalisme prend son essor en France, Roparz Hemon fustige l'état d'"empoisonnement qui tue l'Occident aujourd'hui" ou encore la "putréfaction" dans laquelle il se retrouve aux lendemains du premier conflit mondial : « les grandes littératures européennes, affirme-t-il, sont aujourd'hui pourries… » A cette situation de déliquescence, il oppose « l'esprit sain, l'esprit vigoureux, pur, large, riche, qui vivifiera et sauvera la Bretagne… » Il précise sa pensée en d'autres termes : « la règle de notre jeune littérature bretonne n'est pas la règle des littératures étrangères pourries… »
Aux yeux de Roparz Hemon, pourtant, la Bretagne aussi se trouve pour l'instant en état de décadence. La responsabilité en incombe à nos ancêtres : « c'est de la faute de nos pères si [la Bretagne] en est réduite au triste état dans lequel elle se trouve, de par leur ignorance et leur indifférence ». Mais nos contemporains ne font pas mieux et se complaisent dans leur état de sujétion : « nous avons été accablés, vaincus, opprimés, soumis, et aujourd'hui nous sommes toujours des esclaves. Qui plus est, nous nous réjouissons, la plupart d'entre nous, de notre esclavage ».
D'un éditorial à l'autre, Roparz Hemon réitère les mêmes convictions : « il n'y a pas aujourd'hui de peuple dont le sort soit plus misérable que le peuple breton. Nous avons toujours été irréfléchis, paresseux, anti-patriotes, disposés à lécher les talons de l'étranger, portant le joug comme des animaux domestiques ». Il n'est pas tendre pour ses compatriotes : « les peuples courageux gagnent, les peuples lâches sont vaincus. On ne peut pas réfuter cette vérité ».
Repousser l'esprit de la France, voilà la priorité
La dichotomie hémonienne se présente dès lors dans des termes d'une très grande simplicité. Commentant les conséquences de la première guerre mondiale, il écrit : « un monde, en 1914, est mort. Un monde, en 1918, est né. La vieille Bretagne a disparu, la putain avait reçu l'étranger dans son lit. Qu'elle pourrisse maintenant dans sa tombe entre quatre planches… » Le monde de Roparz Hemon se partage en deux seules réalisations : la Bretagne, qui correspond à la nation de référence ; l'ailleurs, qui est l'étranger. En permanence, le fondateur de Gwalarn oppose « l'esprit national et l'esprit étranger ». Constamment, il se demande « comment tenir tête à l'étranger […] : avant de bouter l'étranger hors de votre pays, boutez-le hors de votre âme ».
Puisque l'étranger est en place pour ronger et infiltrer l'esprit breton de l'intérieur, Roparz Hemon ne se gêne pas pour le nommer : l'étranger, en fait, ne vient pas de loin, c’est d’abord et surtout le voisin français, omniprésent. Tout ce qui est français lui fait proprement horreur. La langue française en particulier suscite de sa part une profonde aversion. Or, c'est l'esprit de soumission de la majorité des Bretons qui conduit à la francisation :
« quelques courageux se sont levés pour sauver notre liberté. Mais la plupart d'entre nous, comme d'habitude, se sont soumis. Nous aurions pu, au moins, conserver une culture. Nous n'en avons conservé que des bribes. Nous avons été francisés. Si nous n'avons pas été complètement francisés, nous devons en remercier Dieu, et non pas nos ancêtres. Nos vêtements francisés, notre langue francisée, notre pauvre littérature francisée, nos arts francisés, notre esprit, dans les villes surtout, francisé ».
Les Bretons, pour préserver leur esprit national, ne savent même plus s'opposer à cette intrusion chez eux du français et de la France :
« Ce sont des Français souvent qui les éduquent, la plupart d'entre eux, dans des écoles françaises, selon des méthodes françaises. Tout l'enseignement qu'ils ont reçu était en français. Ce qu'ils savent le mieux concerne la France : la littérature de la France, l'histoire de la France, la géographie de la France. Leurs maîtres toujours n'ont eu qu'un désir, qu'un souci : les éduquer comme des Français. Sortis de l'école, que lisent-ils, si ce n'est des livres français, des journaux français ? qu'entendent-ils, si ce n'est des discours français, des pièces de théâtre françaises ? des fransquilloneries [3] et rien d'autre. Si bien qu'ils en arrivent tous, même s'ils sont parfois de bons Bretons, souvent malgré eux, à être des vrais Français, puisque leur esprit est français ».
La conclusion logique de cette diatribe est un mot d'ordre : « repousser l'esprit de la France, voilà la priorité ».
Et pourtant, nous sommes tous des francophones…
Il est sûr que le système éducatif ne faisait guère de place alors à quelque approche que ce soit de la langue et de la culture bretonnes. La vision radicale de Roparz Hemon le conduit alors à qualifier le français de « langue de l'étranger », et en tant que telle, elle ne présente pour lui qu'un intérêt limité : « comme tout un chacun, je sais que la littérature de France est belle ; comme tout un chacun, je sais que l'on peut, à l'aide du français, acquérir sur tout de profondes connaissances […] Mais il ne faut pas en rajouter : le français sert, avant tout, à connaître la France ».
Il précise plus loin cependant que les Bretons ne peuvent pas se passer brutalement du français : « il faut néanmoins employer le français. Il nous faut et il vous faut parler français, ne serait-ce que pour écrire l'adresse de nos amis sur les lettres [4]. De plus, ce serait une erreur d'abandonner complètement le français, avant de demander s'il peut ou non nous être utile… »
Un certain pragmatisme lui fait prendre en compte la réalité : « nous sommes tous des francophones […] Parlons français, nous serons compris partout en Bretagne. Imprimons un journal en français : il sera lu partout en Bretagne ». Alors que son idéal serait un enseignement unilingue breton, il admet que « le breton ne peut, en son état actuel, être la langue de notre culture. Et c'est vrai… »

Analysant la situation linguistique de la Bretagne, le directeur de Gwalarn répartit la population bretonne en trois catégories :
- tout d'abord un petit groupe de gens instruits, environ 300 personnes, des ecclésiastiques, des enseignants, des avocats, des médecins, des étudiants : ceux-ci peuvent assez bien écrire le breton, et toute la production écrite de langue bretonne est à leur portée. « Quoique peu nombreux, ils ont la plus grande influence au regard de notre nationalité ; l'avenir de notre langue et de notre culture est entre leurs mains ».
- les Bas-Bretons, en général analphabètes en leur langue, ou s'ils ne le sont pas, incapables de comprendre autre chose que le dialecte de leur canton.
- les autres, uniquement francophones.
Mais tous, dans les trois groupes, savent le français et peuvent lire et écrire le français, bien que « très mal, en général ».
Avec le français, ils peuvent aller jusqu’à Saïgon. Mais la plupart n’iront en ville que pour vendre un sac de pommes de terre
Hemon, sur ce point, doute de l'intérêt qu'il y ait à faire apprendre le français aux petits Bretons pendant des années d'étude :
« Prenez une école dans une commune de Basse-Bretagne : à combien des enfants qui y sont assis le français apportera-t-il suffisamment pour les dédommager des heures qu'ils auront passées à l'apprendre ? […] Avec leur français ils peuvent aller jusqu'à Rennes et Paris, jusqu'à Tunis et Saïgon s'ils le veulent, alors qu'ils vivront toute leur vie dans leur commune parmi des bretonnants comme eux. Ils feront usage de leur français, la plupart d'entre eux, pour vendre un sac de pommes de terre en ville, ou pour lire un journal (qui pourrait être rédigé en breton). En vérité, dites-moi, vaut-il la peine de perdre des heures à leur apprendre une langue, dont ils n'auront besoin qu'une fois de temps en temps ? »

Ce dernier passage vaut la peine d'être analysé. Pour son contenu idéologique, et tout d'abord pour tout ce qu'il admet sans oser le dire. Roparz Hemon reconnaît en effet implicitement :
a) que les villes en Basse-Bretagne sont francophones, de fait
b) que le français est indispensable pour les transactions commerciales
c) que la presse d'information de langue française pénètre dans les campagnes bretonnantes.
Malgré cela, il considère l'étude du français par les petits bretonnants comme une véritable perte de temps :
a) parce que l'apprentissage en est difficile
b) parce qu'ils n'auront pas à vivre ailleurs que dans des communes bretonnantes
c) parce qu'ils n'auront qu'exceptionnellement à se déplacer en dehors de leur pays
d) parce que la presse dont ils auront besoin pour s'informer pourrait aussi bien être rédigée en breton.
Le problème est, à cet égard, que Roparz Hemon ne répondait à une nécessité que par une éventualité : il n'existait pas de grande presse d'information en langue bretonne, ni au moment où il écrivait ni aujourd'hui. Il traduit, d'autre part, des potentialités en impossibilités : il reconnaît, certes, la nécessité du français pour les échanges avec l'extérieur (échanges commerciaux avec la ville voisine, déplacements dans des pays proches ou lointains, y compris en… Haute-Bretagne), mais, considérant l'intérêt limité que peuvent avoir ces échanges pour les intéressés (il ne s'agit, après tout, que de gens qui ne sortiront de chez eux que pour vendre… quelques sacs de pommes de terre…), il n'en définit pas moins le français comme superflu pour les Bas-Bretons, les condamnant du même coup à ne pas pouvoir envisager la moindre transformation de leur situation, autrement dit à l'immobilisme.
Tuons le français, ou le français nous tuera
Si Roparz Hemon admet, et nous l'avons vu, que ce serait « une erreur d'abandonner complètement le français », il envisage néanmoins allègrement que tous les bretonnants n'en aient pas la maîtrise. Dès lors, il multiplie les anathèmes à l'adresse du français :
- « Que cessent cette cruauté, ce crime dirais-je, contre des enfants sans défense : les obliger, pour amasser leur peu de savoir, à utiliser une langue qu'ils ne connaissent pas bien… »
- « La Bretagne gagne-t-elle à l'aide du français plus qu'elle ne perd ? Le français est-il […] un gain ou une perte ? Je le dis, c'est une perte… »
- « Dire, par ailleurs, que tout le monde en Bretagne doit savoir le français, sous prétexte que la moitié des Bretons le parlent, n'est qu'une erreur… »
- « Nous pouvons nous passer du français. J'irai encore plus loin maintenant : en tant que Bretons, nous devons nous en passer. Régionalisme et bilinguisme vont de pair. Nationalité et unilinguisme aussi. Le français dans nos écoles, c'est l'esprit français parmi nous. Et tant que l'esprit français vivra parmi nous, notre nationalité sera en danger… »
- « Tuons le français, ou le français nous tuera. Chacun d'entre nous veut soutenir le breton. Que chacun d'entre nous veuille bien désapprendre le français, lutter contre lui partout et toujours, lutter pour une Bretagne entièrement bretonne et non pas à demi-française… »
- « Il nous est inutile de travailler pour le breton, si nous ne luttons pas simultanément contre le français. Lutter contre le français en Basse-Bretagne est un devoir. Lutter contre le français de toutes les façons, ce n'est pas aller à l'encontre de la justice… »
- « que chacun d'entre nous veuille désapprendre le français, lutter contre lui partout et toujours, lutter pour une Bretagne entièrement bretonne, et non à demi-française ».
« Le breton est pour nous la liberté ; le français l'esclavage »
Les citations précédentes reflètent la position de Roparz Hemon à l'égard de la langue française. Que représente alors pour lui la langue bretonne ? La réponse tient en un axiome : "le breton est pour nous la liberté ; le français l'esclavage… »
À partir de là, l'écrivain fait un choix, qui ne peut être que celui qu'il vient de formuler en termes de liberté :
« Entre le breton et le français, il faut choisir. C'est le breton que nous choisirons, ou bien nous ne serons que des enfants, et pis, des lâches. Et si nous choisissons notre langue, ce n'est pas parce qu'elle est la langue de nos pères, ni notre langue bien-aimée, ni la langue du cœur, ni toutes les inepties que l'on a coutume d'entendre de la part de gens qui ne savent rien faire sans s'excuser. Nous choisissons notre langue parce que nous voulons la choisir, et nous abandonnons l'autre langue parce que nous voulons l'abandonner… »
Il ajoute :
« Est-ce que la Bretagne est une nationalité ? Alors, pourquoi n'aurait-elle pas comme toute nationalité, le droit, et le devoir, de se servir de sa langue, sans demander le secours de la langue de l'étranger ? Pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser le breton dans nos écoles, le breton seulement ? Pourquoi devrions-nous apprendre une autre langue ? Et pourquoi cette langue serait-elle le français, plutôt que l'anglais, l'italien ou le russe [5] ? »
Ces formulations témoignent d'un certain irréalisme : comment aurait-il été possible de remplacer l'étude du français par celle de l'italien ou du russe dans les écoles de Bretagne ? Elles ne laissent guère de place, en tout cas, à la discussion : Roparz Hemon pose la question de savoir si la Bretagne est une nationalité, mais estime inutile d'y répondre. De ce postulat découle un principe : que l'enseignement ne soit dispensé qu'en breton dans les écoles.
Le rapport de Roparz Hemon à la langue bretonne est plus complexe cependant. Le directeur de Gwalarn est convaincu des capacités propres du breton, et dès 1926 il énonce ce dont le mouvement littéraire ou linguistique ne cessera de se servir comme argument : « l'on peut exprimer en breton autant que l'on peut exprimer en français ».
« Notre littérature continue à s'exprimer en patois, alors qu’il nous faudrait une langue civilisée »
Car il y a breton et breton. Celui dans lequel s'expriment la plupart des locuteurs au quotidien n'est pas le bon. En ce temps-là, on ne formulait pas ce constat en termes de diglossie, et ce breton-là, Roparz Hemon le considère carrément comme un « patois ». La langue littéraire elle-même, jusqu'au moment où le maître s'apprête à intervenir, n'est qu'un patois : « notre littérature n'a pas encore enlevé ses sabots, et elle continue à s'exprimer en patois, sous prétexte qu'elle n'a pas honte d'être une paysanne… » L'écrivain regrette l'échec des tentatives du passé pour se débarrasser des patois et élaborer « une langue unifiée, civilisée, bien ordonnée, bien peignée… » Lorsqu'il traduit une pièce galloise en breton, ce n'est pas « dans le patois de Vannes, du Trégor, de la Cornouaille ou du Léon. J'ai préféré la traduire en breton littéraire, et essayer de lui conserver sa majesté, sa simplicité et sa poésie ».
Roparz Hemon n'est cependant pas si sûr de la qualité de son breton, et il envie les auteurs populaires : « pourvu que nous soyons un jour aussi habiles en notre breton littéraire qu'ils l'ont été en leur breton patois ! » Mais quand il élabore un nouveau dictionnaire, ce n'est pas pour y inclure des tournures de la langue populaire, ni davantage pour y intégrer les acquis de la linguistique [6] : souverainement, il décide de n'y faire figurer que les termes qu'il a collectés chez les créateurs du breton littéraire, chez ses collaborateurs et… dans ses propres œuvres ! La terminologie comme la problématique linguistique hémoniennes sont significatives de ses a priori : la qualification de la langue bretonne généralement en usage en terme de « patois », les options affichées en faveur d'un purisme lexical érigé en doctrine et en faveur d'une langue littéraire dont il reconnaît par ailleurs qu'elle n'existe pas encore vraiment, révèlent à nouveau les choix d'ordre idéologique retenus par son fondateur pour l'école de Gwalarn.
N’écrire que pour les lecteurs de Gwalarn en attendant que… « les autres aussi soient capables de comprendre ! »
Ses choix vont déterminer sa praxis. Son objectif n'est pas de convaincre la masse, le peuple. C'est en effet par la littérature que Hemon veut revivifier la nationalité bretonne : « nous voulons donner à la Bretagne une littérature qui l'éclairera. Lui donner une voix qui parlera à ses meilleurs enfants, si bien qu'ils s'arrêteront d'écouter la voix de l'autre pays… » Alors que les bretonnants n'apprenaient ni à lire ni à écrire leur langue à l'école, il décide de publier une revue littéraire.
Il s'attend bien à ce qu'un tel projet ne recueille de la part de ses compatriotes qu'une adhésion limitée. Mais il est prêt à n'écrire que pour cinquante lecteurs, pour vingt, pour dix, pour lui-même s'il le faut. Il n'écrit donc que pour les lecteurs de Gwalarn, en attendant que… « les autres aussi soient capables de comprendre » ! C'est d'ailleurs l'idée centrale du « Premier et dernier manifeste de Gwalarn en langue française » publié en février 1925 sous la signature commune de Roparz Hemon et d'Olivier Mordrel : « nous répétons ce que nous avons dit tant de fois : le sort de notre littérature, auquel est lié celui de notre langue, et par suite, celui de notre nationalité, est entre les mains de l'élite [7] ».
« Créer en dépit de tous et contre tous une vie nationale en Bretagne »
Dans son entreprise littéraire, Roparz Hemon adopte en effet le parti de l'esthétisme : « je réclame de la beauté, et de la lumière en notre langue. » Et simultanément, celui de l'élitisme :
« Est-ce à vous de perdre votre temps à apprendre les patois ? Ou au peuple de s'éduquer en apprenant la langue unifiée […] Presque toutes les erreurs que l'on a commises jusqu'à présent en Bretagne par rapport à la langue proviennent de ce faux principe de base : il faut que les leaders aillent vers le peuple ; ce n'est pas au peuple de venir vers les leaders. Celui-là cependant était dans le vrai, qui disait que les montagnes devaient venir vers lui, et non pas à lui d'aller vers les montagnes. La première chose à faire, malgré tout, est d'apprendre à bien les solliciter ».
La méthode retenue par Roparz Hemon ne consiste pas à recueillir l'assentiment général : le résultat devra être atteint malgré les oppositions. Dans le passage suivant, le contraste n'est pas que grammatical entre la langue et l'histoire que l'auteur s'approprie en termes de "notre langue" et de "notre histoire", marquant ainsi sa propre vision de l'une et de l'autre, et celles qu'il faut inculquer "à nos compatriotes", qu'il faut "leur" apprendre, puisque la langue qu'ils parlent n'est pas la bonne :
« La Bretagne sera sauvée le jour où nous aurons créé en dépit de tous et contre tous, une vie nationale en Bretagne […] Le jour où nous aurons appris à nos compatriotes à lire et à écrire notre langue ; le jour où nous leur aurons exposé notre histoire; le jour où nous aurons perfectionné notre langue, formé notre littérature… [8] ».
Le breton sera, bien entendu, une langue d'État, la langue d'un état qui n'existe pas encore, mais dont on anticipe en quelque sorte la création, en faisant comme s'il existait : "si l'on ne s'efforce pas de restituer au breton sa véritable place comme langue de la connaissance, de la littérature, de l'enseignement et de l'État […] cela ne vaut pas la peine de lutter pour lui".
Culte du chef, prééminence de la paysannerie et mépris pour la classe ouvrière
Il n'est pas étonnant que cette prospective conduise tout droit Roparz Hemon à regretter que la Bretagne et la langue bretonne n'aient pas encore de guide, pour leur tracer le chemin à suivre : « Où sont nos grands leaders, nos grands poètes ? Y a-t-il un Breton que nous puissions comparer aux héros de l'Irlande, de la Bohème, de la Catalogne ? » En 1930, il se plaint toujours que nous n'ayons pas encore « de leaders, de vrais leaders ».
Le culte du chef s'accompagne de la prééminence accordée à la paysannerie et de mépris pour la classe ouvrière : si la Bretagne avait un chef, il pourrait aider la classe paysanne, la seule qui soit restée bretonnante, à prendre le pouvoir :
« Il n'y a pas de meilleure façon pour sauver le pays que d'élever et éclairer les paysans de Basse-Bretagne, qu'ils deviennent les maîtres du pays… Éclairer la paysannerie, voilà le but […] Les habitants des villes, par ailleurs, sont tous des employés, qui vivent des subsides du gouvernement, ou des ouvriers, qui ont assez à faire à gagner leur pain, - et qui sont, tare suprême - presque francisés de surcroît… »
Le peuple n'a pas encore fait du breton la langue nationale de la Bretagne. Il n'a pas encore adopté la langue littéraire comme moyen principal de communication. Il n'a pas rejeté le français, comme on l'y a invité. Concernant la langue bretonne, le contraste est considérable entre les positions d'un Yves Le Febvre ou d'un Emile Masson et celles de Roparz Hemon. Aujourd'hui, personne ne se réclame du premier, et bien peu du second : Le Febvre, un républicain, se refusait à envisager un avenir pour la langue bretonne ; Masson, un libertaire, ne concevait l'émancipation du peuple breton que s'il parvenait à s'approprier lui-même sa langue.

Seul Roparz Hemon, le nationaliste, a une véritable postérité. Le peuple n'a pas reconnu son leader, mais le mouvement littéraire breton d'inspiration nationaliste a fait de lui le chef dont il avait diagnostiqué le manque. C'est que le nationalisme de Roparz Hemon, avec les contradictions qu'il contient en lui-même, est un intégrisme.
- Sur le plan linguistique, il est puriste : il refuse la langue bretonne telle qu'elle est, et la conçoit seulement comme elle devrait être.
- Sur le plan littéraire, il est élitiste : ses choix d'esthétisme lui font admettre de n'écrire que pour un public limité.
- Sur le plan social, il est autoritaire : il est convaincu que la petite bourgeoisie intellectuelle d'enseignants, médecins…, qu'il a regroupée autour de Gwalarn, pourra en s'appuyant sur la paysannerie imposer ses vues à toute la Bretagne.
- Sur le plan moral, il est normatif : la dichotomie hémonienne classe les Bretons en deux seules catégories : d'un côté, les lâches, de l'autre les patriotes.
On peut même dire que son nationalisme est bien plus qu'un conservatisme, un fascisme naissant. Il est en concomittance avec les mouvances d'extrême-droite émergentes en Europe à la même période, qu'elles soient intellectuelles ou politiques [9] : dénonciation des littératures pourries, xénophobie, culte du chef… Si Hemon a séduit, c'est parce qu'il a théorisé à l'extrême une perspective qui ne condamnait pas la langue bretonne à la déchéance, et qui, du même coup, a été considérée pour elle comme positive et valorisante.
En préface à la première édition de son recueil en 1931, il reconnaissait déjà qu'il contenait plusieurs passages qu'il n'aurait plus rédigés dans les mêmes termes, et il le confirmait dans une note liminaire à la seconde édition en 1972. Dans Eur Breizad oc'h adkavout Breiz, la pensée hémonienne n'en est donc encore qu'à sa première formulation [10]. Mais si les éditions Al Liamm [Le Lien], fréquemment citées comme la plus importante maison d'édition de langue bretonne, ont cru bon en 1972 de rééditer l'ouvrage fondateur du mouvement linguistique et littéraire d'inspiration nationaliste, c'est que les théories de l'auteur, bien que datées, ne sont pas considérées comme anachroniques [11].
Notes
[1] Louis-Paul Nemo, écrivain et linguiste breton (1900-1978). Né à Brest, il obtient l'agrégation d'anglais en 1924 et devient professeur au lycée de Brest. Sous le pseudonyme de Roparz Hemon, il a fondé la revue et les éditions Gwalarn, publié quantité de manuels de breton, de romans, nouvelles, pièces de théâtre, etc… qui en font l'auteur de langue bretonne le plus prolixe du XXe siècle. Pendant la guerre, il anime des émissions en breton à la radio, sous contrôle allemand. En 1941, il prend la tête du Framm Keltiek [l'Institut celtique], à Rennes. Condamné à 10 ans d'indignité nationale à la Libération, il émigre en Irlande, où il collabore à l'Institute for Advanced Studies. À partir de 1958, il édite un Dictionnaire historique de la langue bretonne. Louis-Paul Némo est décédé à Dublin en 1978. Il a été inhumé à Brest.
Lucien Raoul. - Geriadur ar skrivagnerien ha yezhourien. Brest : Al Liamm, 1992. - P. 321-325.
Abeozen. - Istor lennegezh vrezhonek an amzer-vremañ. - Brest : Al Liamm, 1957. - P. 113-118 + 200-203.
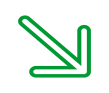
[2] Roparz Hemon. - Eur Breizad oc'h adkavoud Breiz. - Brest : Moul. ar C'hastell, 1931. - 265 p.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réédition : Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh. - Brest : Al Liamm, 1972. - 252 p.
En préliminaire à la seconde édition de 1972, l'auteur fait observer qu'il n'a "presque rien modifié" à son contenu. Il ne semble pas que cette assertion corresponde à la réalité, puisque, indépendamment du changement d'orthographe, de 350 à 400 « corrections » peuvent être relevées de l'une à l'autre édition. Certaines ne prêtent nullement à conséquence, mais d'autres consistent en des rectifications grammaticales, lexicales ou syntaxiques, au point de transformer le propos initial. Par ailleurs, la seconde édition ne reprend pas l'article Studi ar yezoniez [L'étude de la linguistique], dans lequel il traitait hardiment les celtisants de l'époque (Loth, Vendryes…) d'imbéciles (genaoueg) et de sots. Voir à ce sujet : J.S. - Hag eo Roparz Hemon eun doue ? - Brud Nevez, n° 96, miz even 1986, p. 60-67.
Nos citations font référence à la première édition. Cet ouvrage n'ayant pas fait, au moment de la rédaction de la thèse, l'objet de traduction, toutes les citations, sauf exception que nous mentionnerons, ont été traduites en français par nos soins.
[3] Littéralement : « des choses françaises. » On peut dire, à la manière des Belges, des fransquillonneries…
[4] Roparz Hemon n'avait pas alors imaginé de revendiquer que l'on puisse rédiger les adresses postales en breton. Cela se fera ultérieurement…
[5] Ces deux passages ont été traduits par F. Morvannou dans La littérature de langue bretonne au XXe siècle. In : Histoire culturelle et littéraire de la Bretagne. Tome III / sous la direction de Jean Balcou et Yves le Gallo. - Paris : Genève : Slatkine, 1987. - P. 208.
[6] L'attitude de Roparz Hemon est alors très critique vis-à-vis de la linguistique. Dans un chapitre, qui n'a pas été reproduit dans la seconde édition, il affirme n'avoir pas de mépris pour la science, mais avoue qu'il observe les travaux de la linguistique bretonne classés côte à côte sur les étagères de sa bibliothèque avec beaucoup de détachement, comme « un troupeau de moutons : il n'y en a aucun, pour moi, qui soit vraiment meilleur que l'autre ». Selon lui, déterminer l'avenir d'une langue sur la base de la linguistique serait « une folie ».
[7] Cité par : Michel Nicolas. - Le séparatisme en Bretagne. - Brasparts : Beltan, 1986. - P. 240.
[8] Youenn Olier critique Roparz Hemon sur ce point en considérant sa vision du peuple breton comme largement mythique. Voir : Youenn Olier - Un tonkad hag un oberenn. - Imbourc'h, n° 247, gouere 1990, p. 38-39.
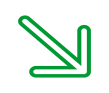
[9] Dans l'Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne, F. Morvannou analyse assez longuement un article publié dans la revue Al Liamm en 1950 par Roparz Hemon, dans lequel, évoquant ce qui se fit pour la langue bretonne sous l'Occupation allemande, l'ex-directeur de Gwalarn écrit notamment que « pendant quatre ans, de 1940 à 1944, il passa un vent de liberté sur la Bretagne… » L'explication de F. Morvannou consiste à dire qu'il avait complètement « isolé » son combat pour la langue du contexte général de l'époque, cette attitude aboutissant effectivement à « une sorte d'égarement de l'intelligence et du cœur ». Mais s'agit-il seulement d'égarement ? Et si l'action de Roparz Hemon s'était alors tout simplement située dans la logique de ses positions antérieures ? Il paraît difficile d'isoler son comportement pendant la dernière guerre des analyses qu'il avait développées les années précédentes. Il ne serait, après tout, pas surprenant que Roparz Hemon ait développé de telles analyses et qu’il y reste fidèle y compris dans l’après-guerre, alors que le mouvement breton – et Breiz Atao particulièrement, dont il était issu - avait également évolué vers des positions fascisantes.
[10] Les derniers chapitres du livre témoignent d'une certaine évolution, en particulier lorsque Roparz Hemon écrit que « si une littérature veut s'épanouir et réaliser, elle doit se rattacher à la vie sociale plus qu'à la vie personnelle, la littérature de la masse plus que celle de l'individu et des émotions de son cœur […] La vie doit nourrir la littérature ». Moins de cinq ans après avoir créé Gwalarn, son directeur reconnaît donc son erreur d'avoir tout misé sur la littérature : il a perdu l'espoir qu'il avait mis « dans le pouvoir de la Beauté pour ressusciter l'esprit d'un peuple ». Mais si Roparz Hemon annonce une nouvelle pratique, l'orientation reste identique, et les objectifs inchangés : « c'est bien de créer une littérature. Il est encore mieux et plus nécessaire de créer la vie. Car sans une langue convenable, sans enseignement, sans conscience nationale, quelle vie peut-il y avoir dans un pays ? »
[11] L'ouvrage Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh a de nouveau été réédité aux éditions Al Lanv en 2020. L'éditeur en fait la promotion dans les termes suivants : "Les réflexions de Roparz Hemon nous révèlent le sens de son engagement pour la Bretagne et la langue bretonne". C'est exactement ce que nous analysions dans le texte ci-dessus, rédigé dans les années 1990. La présente note est une mise à jour de mars 2025.
Pour contacter l'auteur ou pour transmettre un commentaire :
© 2018-2025 - La pratique du breton
Site réalisé avec Webacappella Responsive
Autres sites signalés